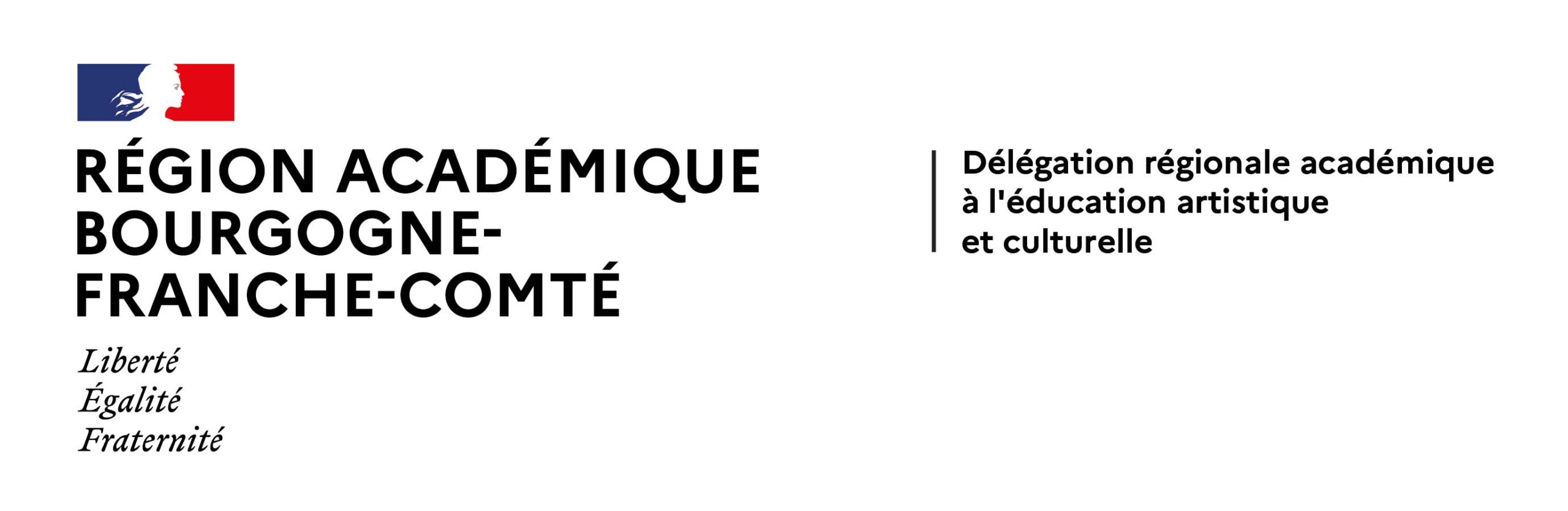Le 23 Janvier 2025, le CDI du collège Saint-Charles-Saint-Dominique a accueilli un projet pédagogique pour 153 élèves sous forme d’ateliers participatifs animés par deux acteurs de la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne autour de l’oralité et des langues locales.
En guise d’entrée en matière, Morgane Bouchard, coordinatrice des projets liés à l’oralité, a proposé une réflexion dialoguée sur ce thème. Cette phase de découverte du patois local a pris la forme d’un jeu de devinettes où les élèves s’amusaient à deviner le sens de mots en patois tirés au sort. Morgane a ensuite diffusé des enregistrements tirés du vaste fonds sonore de la MPOB. Il s’agit de plusieurs variantes d’une berceuse dont sont soulignées les spécificités pour montrer la diversité linguistique locale. La berceuse permet également d’illustrer la notion de transmission sur laquelle repose entièrement l’oralité. A l’issue de cette introduction, les élèves ont pu se familiariser avec la réalité linguistique de l’oralité et avec l’idée de transmission, qu’elle soit familiale, intergénérationnelle ou plus généralement culturelle.
Deux ateliers aux contenus complémentaires ont été proposés aux élèves. Pour commencer, Pierre Léger, président de la section Langues de Bourgogne de la MPOB, a projeté la carte des différentes langues et patois parlés en Bourgogne pour introduire l’atelier en patois bressan-chalonnais – autrement dit : C’ment qu’on y cause à Chalan.
Du chant des conscrits au match de rugby
Pour entrer dans le vif du sujet, les élèves ont découvert le chant des conscrits de Saint-Marciaux. A l’aide de photographies d’époque, M. Léger a contextualisé le vocabulaire utilisé en évoquant une coutume, la canne (bôton) des conscrits, et en expliquant son lien avec les traditions datant de l’époque où les jeunes hommes partaient servir leur pays pendant de longues périodes allant jusqu’à sept ans. Le refrain de ce monologue anonyme toujours transmis aujourd’hui a rapidement été assimilé par les élèves, qui se sont approprié les réalités sonores du patois bressan-chalonnais.
Une deuxième activité s’est appuyée sur la projection en vidéo « d’un match d’rugby à Chalan », un monologue humoristique conté en 2012 par M. Louis Guichard. Les élèves ont spontanément saisi tous les effets comiques d’un monsieur qui découvre le rugby sans en connaître les codes. Des fiches d’exercices lexicaux ont été distribuées aux élèves pour qu’ils associent les mots de patois à des illustrations (noms d’animaux, parties du corps, vocabulaire usuel). Le lexique étant identifié, les élèves ont traduit des passages du monologue, du patois vers le français d’abord (« version »), puis du français vers le patois (« thème »). Cette démarche linguistique raisonnée proposée a été menée avec plaisir par les élèves qui ont apprécié de trouver les « solutions » et de partager leurs résultats.
Le troisième volet de l’atelier a porté « Le Roi des poissons ou La Bête à sept têtes », un conte merveilleux collecté dans le Morvan par Achille Millien vers 1885 qui a été choisi et qui reprend un grand nombre de mots vus dans les activités précédentes. Dans l’esprit de la tradition orale, Pierre Léger a relaté cette histoire en patois tout en invitant subtilement les élèves à proposer des mots, des fins de phrase, afin de participer à la narration et d’alimenter le flot du récit. Ainsi, le récit est devenu un terrain de partage entre le conteur et son auditoire, les mots de patois constituant à la fois le matériau de l’histoire et les vecteurs d’une transmission informelle.
Le Petit Chaperon rouge, vu du Morvan… et du Missouri
Le second atelier participatif a également porté sur le conte, un genre qui a bel et bien constitué le fil directeur de ce projet mené dans le cadre des Nuits de la lecture.
Morgane a raconté « Lai P’tiote Feille Peu l’loup », une version morvandelle du Petit Chaperon Rouge collectée à Glux-en-Glenne par Achille Millien vers 1885 auprès de Me Maillot. Cette version était enrichie de quelques variantes afin de montrer l’influence de la circulation des langues sur les 35 versions du Petit Chaperon Rouge telles qu’elles sont répertoriées dans l’ouvrage de P. Delarue et M.-L. Tenèze, Le Conte Populaire Français. Catalogue Raisonné des Versions de France et des Pays de Langue Française et d’Outre-Mer (éditions Maisonneuve et Larose, 1997).
L’animatrice a expliqué comment la circulation du conte est indissociable de celle des personnes. A titre d’exemple, on retient qu’aux sources de l’Yonne, à Glux-en-Glenne, on reste sur « Lai P’tiote Feille » mais qu’outre-Atlantique, dans cette autre aire de francophonie qu’est le Missouri, aux Etats-Unis, une variante du conte a été répertoriée avec une fillette et un garçon : « le p’tsit Jupon Rouge et pis le p’tsit Chapeau Rouge » (Old Mine, Etat du Missouri).
Ces ateliers, à travers la variété des supports et des activités, ont permis aux élèves d’appréhender l’oralité comme une source de transmission dynamique, en perpétuelles circulation et régénération, à l’image des langues vivantes. Les contes ont su captiver les élèves dans une atmosphère enjouée et conviviale, conformément aux traditions de l’oralité en Bourgogne.