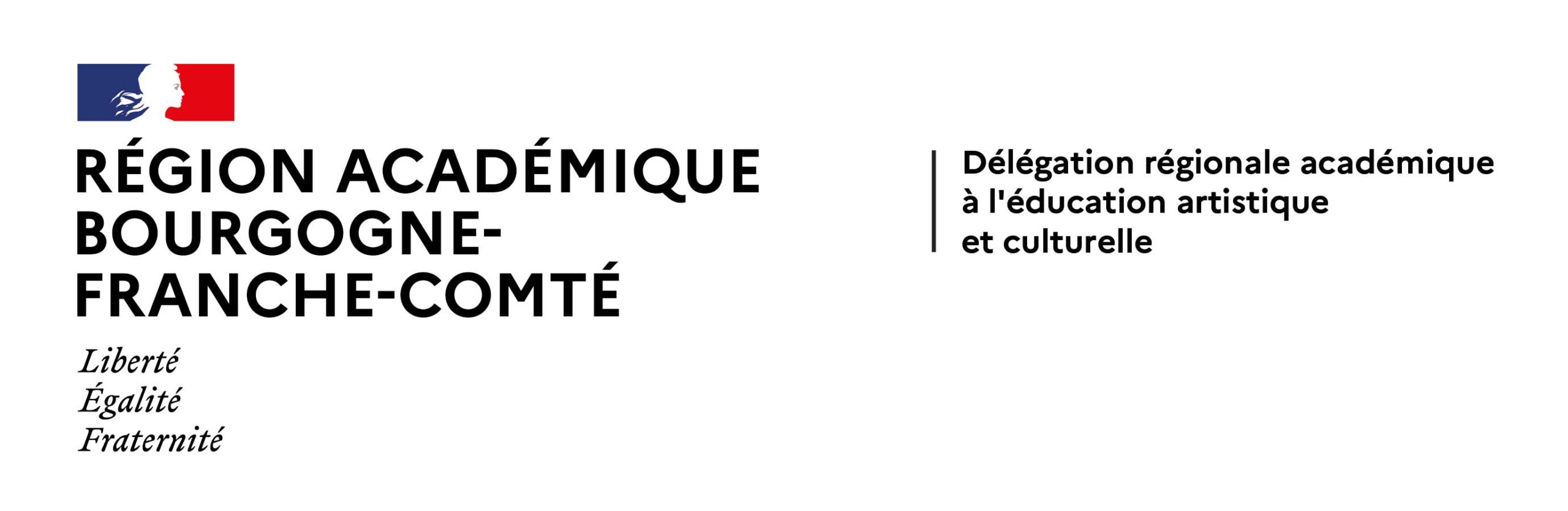27 stagiaires, issus de différentes catégories professionnelles (professionnels de l’Éducation nationale, professionnels du monde de l’art ou de la culture, professionnels du secteur de l’enfance et de la jeunesse, professionnel de l’enseignement agricole) et venant de différentes régions, se sont retrouvés durant trois jours à l’occasion de la formation PREAC programmée par le service des publics du musée Nicéphore Niépce et ont pu étudier la question du point de vue dans l’image photographique.
En août 1827, Nicéphore Niépce enregistre la première image (connue) à l’aide de la lumière. Il ne nomme pas cette image « photographie » (écrire avec la lumière) – terme plus tardif – ni « héliographie » (écrire avec le soleil) – nom donné à son invention – mais « point de vue ». Cette première image intitulée Point de vue du Gras porte ainsi un titre descriptif témoignant de l’endroit depuis lequel l’inventeur a capturé une vue (par la fenêtre de son domaine du Gras à Saint-Loup-de-Varennes).
Ainsi, dès les prémices de la photographie, la question du point de vue est posée comme un élément fondamental. En effet, ce terme recoupe différentes acceptions. Ce peut être le point de vue physique, le lieu depuis lequel le photographe (l’opérateur) regarde et enregistre une image à travers et à l’aide d’un appareil ; le point de vue en tant que vision portée sur le monde, la manière de voir et de représenter un sujet dans une intention particulière, une subjectivité ; et également le point de vue de ceux qui regardent et reçoivent cette photographie par la suite.
Les techniques photographiques ont évolué, les sujets représentés sont multiples, mais toujours cette question reste centrale et décisive dans l’approche pédagogique de la photographie.
A la veille du bicentenaire de l’invention de la photographie qui sera célébré en 2027, et d’un coup de projecteur médiatique sur ce médium artistique, la formation aborde l’enjeu du point de vue pour l’opérateur, au moment de la prise de vue. Elle en explore les questions historiques, théoriques, pratiques, pédagogiques et leurs enjeux.
Ainsi, les stagiaires de la formation ont pu analyser, discuter, interroger leurs pratiques pédagogiques et éducatives autour de divers questionnements : quel héritage et quelles relations entretient la notion de point de vue avec la peinture, la notion de perspective, le développement des sciences optiques ? Quelle position est donnée au spectateur de la photographie face à une image ? Quelle place est donné au réel dans l’acte photographique et quelle représentation en est-il fait ? Quelle relation existe-t-il entre l’être humain, sa vision et celle de l’appareil photographique ? Quelle approche du sujet choisir ? Comment le formaliser par notre place dans l’espace, nos choix techniques et formels ? Le point de vue peut-il être initiateur de nouvelles formes de représentations ?
Objectifs et déroulement de la formation
Ce faisant, les objectifs de la formation étaient :
- d’étudier la notion de point de vue dans un regard analytique : historicité dans le monde des images, rapport à l’appareil de vision (appareil, optique…), intention photographique, protocole de travail…
- de se constituer un socle de références visuelles pour appréhender ce sujet avec un jeune public.
- d’imaginer, de réaliser, d’échanger et de transmettre des pratiques simples pour expérimenter le point de vue photographique
Afin de répondre à ces objectifs, le musée Nicéphore Niépce a organisé des rencontres et activités variées avec de nombreux professionnels de l’image photographique (artistes, photographes, enseignants, médiateurs) :
Des conférences et rencontres avec des artistes et des œuvres
- Une visite du musée (collections permanentes et exposition temporaire « Gregory Crewdson. Eveningside ») animée par les médiateurs du musée
- Une courte conférence par un médiateur dans les salles du musée autour de la première photographie Le point de vue du Gras réalisée par Nicéphore Niépce : conditions de sa réalisation et questionnements intrinsèques au médium photographique.
- Une consultation d’œuvres originales exceptionnellement sorties des réserves suivie d’un échange collectif autour des œuvres rencontrées sur la question du point de vue
- Une conférence animée par Nicolas Bouillard, professeur agrégé d’arts plastiques et formateur académique en didactique des arts plastiques : La question du point de vue : approches historiques, artistiques, pédagogiques et éducatives.
- Une rencontre avec le sculpteur Philippe Ramette intitulée « Une incarnation du point de vue. »
- Une rencontre avec l’artiste et photographe George Rousse qui est revenu sur son œuvre et sa démarche artistique
- La présentation des démarches artistiques singulières de chacun des 3 photographes invités à animer des ateliers de pratique : Morgane Denzler, Baptiste Rabichon et Patrick Tourneboeuf
Des ateliers de pratiques et d’expérimentations de la photographie
- La manipulation de quelques appareils photographiques sur la question du point de vue (visée, position du corps et du regard du photographe par rapport à l’appareil, conditions de prise de vue d’un sujet statique ou en mouvement) par les médiateurs du musée
- Le choix entre trois ateliers de pratique questionnant le point de vue, proposés par trois photographes : Morgane Denzler, Baptiste Rabichon et Patrick Tourneboeuf.
Les stagiaires ont ainsi pu expérimenter différentes approches de la question du point de vue, conseillé par des professionnels de l’image photographique.
- Morgane Denzler a proposé à son groupe une exploration d’un territoire limité à travers la pratique photographique, engageant les participants à s’interroger sur leur ressenti et la manière de le donner à voir par l’image. Comment le ressenti, la rencontre avec un territoire et ceux qui l’habitent permet de développer la subjectivité dans les images ? Comment l’étape de l’editing (sélection) est-elle constitutive d’un point de vue singulier ?
- Baptiste Rabichon a accompagné ses stagiaires dans l’expérimentation de deux techniques fondamentales et rudimentaires : le sténopé et le photogramme. Comment travailler avec un « troisième œil » (qui peut être l’appareil ou le papier) ? Comment dialoguent le regard personnel et l’outil ?
- Patrick Tourneboeuf a questionné l’usage du smartphone dans la pratique photographique lors d’une déambulation, en partant de la problématique du collectif : comment créer une histoire collective par l’image et montrer la manière dont se côtoient les personnes et les espaces ?
Des ateliers pour questionner, discuter, développer des pratiques éducatives et pédagogiques :
- Une présentation de quelques pratiques questionnant le point de vue et menées par le service des publics dans le cadre de leur mission auprès du public jeune et scolaire
- Un atelier-laboratoire d’idées : en fonction des éléments évoqués et expérimentés, des connaissances et compétences de chacun, se sont engagées des réflexions collégiales sur des mises en situation concrètes par les stagiaires, dans leur contexte professionnel. Le travail s’est développé en petits groupes animés et conseillés par les médiateurs du musée. L’atelier-laboratoire a été suivi d’une mise en commun des pistes de réflexion engagées et de propositions de ressources réutilisables.
Présentation des artistes invités
Morgane Denzler
Morgane Denzler est photographe et plasticienne. Elle revisite le médium photographique pour amplifier sa dimension physique et sensorielle des espaces et lieux traversés. Elle donne corps à la photographie dans des sculptures et installations incitant le spectateur à être pleinement acteur de sa découverte. Son travail est inscrit dans le champ de la recherche et de l’art contemporain au profit d’une réflexion axée sur la mémoire, le paysage et l’humain.
Elle développe par ailleurs un travail pédagogique au Plateau 96 de Bruxelles auprès de la collective Indigo.
(artistes en situation de handicap).
Site de la Galerie Bandana Pinel
Baptiste Rabichon
Baptiste Rabichon explore de manière prolifique le médium photographique dans tous ses possibles. Il convie et combine de nombreuses références visuelles, tant issues de l’histoire de l’art que du cinéma, des jeux vidéos.
Expérimentateur de procédés et explorateur de représentations, il questionne notre perception de la réalité par des inversions de valeurs, bouleversements de perspectives ou changements d’échelles. Ne s’interdisant rien, il crée des représentations entre réalités et fictions.
Site officiel de l’artiste
Philippe Ramette
Philippe Ramette est artiste plasticien. Sa pratique se déploie entre photographie, sculpture, installation, dessin… Son travail met souvent en scène un personnage élégant et flegmatique, dans des situations incongrues, absurdes, dans un certain humour visuel. Dans ces saynètes anecdotiques et fascinantes, lerapport au monde du personnage est bouleversé, tout comme le nôtre.
Site du Centre Pompidou
Patrick Tourneboeuf
Patrick Tourneboeuf est co-fondateur du collectif Tendance Floue, créé en 1991. Sa démarche photographique, résolument plastique et systématique, se distingue par un intérêt pour l’architecture, le paysage et l’urbanisme mettant en avant les hommes à travers les espaces qu’ils investissent, abandonnent, ou laissent derrière eux. Le prétexte architectural sert d’invitation à regarder ce qui échappe.
Il travaille à l’observation méticuleuse du banal et de ses empreintes légères, pratiquement impalpables, gommées par le temps. Il considère la photographie comme un outil chargé d’exprimer les tensions de son époque grâce à des cadrages proches du réel. Ses œuvres sont réalisées à l’argentique à la chambre, et sans retouche.
Site du collectif Tendance Floue
Georges Rousse
Georges Rousse est plasticien, une notion globale incluant ses approches de photographe, peintre, sculpteur et architecte. il investit des espaces vides et délaissés, y projetant sa vision dans des jeux de formes et couleurs. Le spectateur est bousculé dans sa perception de l’espace entre illusion et réalité.
Site officiel de l’artiste
Bilan de la formation
Par la richesse de la programmation et la pertinence des intervenants et des questions soulevées tout le long de la formation, le PREAC 2025 a été salué par l’ensemble des stagiaires ayant eu la chance d’y participer. Elle a permis l’émergence de nouveaux questionnements au regard des pratiques professionnelles de chaque participant et sera, sans aucun doute, un tremplin vers de nouveaux projets EAC mettant en avant la photographie. Des ressources retraçant les ateliers suivis par les participants ont été créées à leur destination.
Le musée a d’ores et déjà commencé une réflexion autour d’un projet collectif à partir de l’engagement de différents stagiaires, acteurs culturels et éducatifs répartis sur le territoire français, afin de pouvoir proposer des ressources éducatives faisant suite à ce PREAC.